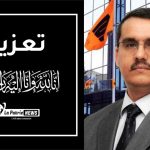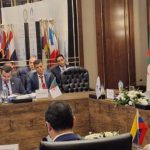Un historien glorificateur de la colonisation tente de discréditer l’historien Benjamin Stora
La vérité historique fait toujours mal chez une certaine France !
(Par Noureddine Khelassi)

Il était attendu que la mission officielle sur la mémoire de la colonisation de l’Algérie, confiée par le président Emanuel Macron à l’historien Benjamin Stora, spécialiste connu et reconnu de l’histoire de la colonisation de l’Algérie et des mémoires inhérentes, n’allait pas être du goût des historiens de garde. Ceux-ci sont très attachés au roman national fondé sur l’idée d’un récit identitaire et glorifié du passé de la France, notamment de son expérience coloniale. En effet, il n’aura donc pas fallu longtemps pour voir un des fleurons du récit identitaire du passé de la France, un gardien du temple très attaché au « roman national », un catholique orthodoxe et royaliste, monter au créneau pour contester le choix de Benjamin Stora. Il s’agit de l’historien Jean Sévillia, chroniqueur en vue du Figaro qui a accusé l’auteur de « La Gangrène et l’oubli » et « La Guerre des mémoires » d’être « partiel et partial » et d’être presque l’historien officiel du…FLN !

C’est donc en toute logique que Benjamin Stora, en sa qualité de spécialiste des mémoires de la colonisation de l’Algérie, a répondu, point par point et arguments solides à l’appui, à cet historien réputé être attaché à la résurgence du « roman national » français, et notamment pour être un des glorificateurs de la colonisation qu’il présente comme une œuvre de civilisation, à l’image d’un vulgaire Laurent Deutsch ou d’un complexe Patrick Buisson.
La tentative de Jean Sévillia de discréditer le choix de Benjamin Stora et de délégitimer par avance le travail qu’il aura à accomplir dans le cadre de la mission que lui a confiée le chef de l’Etat français, montre encore une fois que la vérité historique est toujours complexe. Et qu’elle fait surtout encore mal en France, notamment dans certains milieux intellectuels de droite et d’extrême-droite. A l’image de la réaction polémique et intellectuellement malhonnête de Jean Sévilla, historien négationniste et habitué à mettre sur un même pied d’égalité la violence coloniale et la violence révolutionnaire au titre de la lutte légitime des Algériens pour l’indépendance. En voulant jeter le discrédit sur Benjamin Stora, l’auteur de « Les Vérités cachées de la guerre d’Algérie », tombe lui-même dans les travers qu’il a toujours cru trouver chez les historiens français qui ne glorifient pas la colonisation : l’historiquement correct, l’anachronisme, le réductionnisme, le mensonge par omission, l’indignation sélective, l’occultation de faits précis et le déni.
Pourtant, côté algérien, ce qui est demandé à la France officielle, aux historiens et autres intellectuels, c’est surtout de reconnaître, de manière claire, le fait colonial et les crimes qui lui sont rattachés. Il ne s’agit donc pas pour les Algériens d’exiger le mea culpa et le confiteor car la notion de repentance est mêlée des regrets douloureux que l’on a de ses péchés, de ses fautes et du désir de se racheter. Est-ce bien cela qui est demandé présentement à la France d’aujourd’hui ?

Dans ce pays, le refus de la repentance est toujours porté à bout de bras par une forte pensée philocoloniale développée par l’influent courant de la non-repentance, représenté notamment par Pascal Bruckner, Max Gallo, Daniel Lefeuvre et Jean Sevilla. Cette école philosophico-politique, qui a ses hérauts au sein de la représentation politique et de la société civile, avait trouvé à un moment donné en la personne du président Nicolas Sarkozy, pour le citer en exemple, un adepte enthousiaste et intransigeant. Avec la foi d’un croyant engagé, le sixième président de la Vème République pensait alors que la repentance est une «forme de haine de soi». Que c’est même «une mode exécrable» car «on ne demande pas aux fils d’expier la faute des pères». Dans son esprit, «on ne réécrit pas l’Histoire dans le seul but de mettre la nation en accusation». Mais est-ce bien là la question ou s’agit-il ici de l’expression d’une mémoire toujours à vif qui, sous prétexte de rejeter le «dolorisme» et le «masochisme occidental», refuse d’assumer sereinement le fameux «fardeau de l’Homme blanc» ?
Pourtant les anciens pays colonisés, dont l’Algérie qui a pâti le plus de la colonisation, n’ont jamais été dans une approche foncièrement culpabilisante de l’ex-puissance coloniale. Les anciennes colonies de confession musulmane, elles, peuvent même exciper de l’argument religieux qui veut qu’«aucune âme ne portera le fardeau d’autrui, et qu’en vérité l’homme n’obtient que le fruit de ses efforts» (sourate 62 de l’Etoile, versets 37, 38). En tout cas, il n’a jamais été envisagé de demander à la France d’aller à Canossa. D’exiger précisément d’elle une dure pénitence ou une douloureuse flagellation. Personne ne lui demande donc d’être en robe de bure et tondue, et de s’agenouiller pour demander, profondément contrite, le pardon. D’ailleurs, ni les Algériens, ni les autres peuples qui ont subi eux aussi le joug de la colonisation française ne veulent l’amener à se couvrir la tête de cendres. La reconnaissance du fait colonial et des crimes y afférents, ainsi que les excuses subséquentes ne revêtent aucune forme à connotation religieuse et pénitentielle.
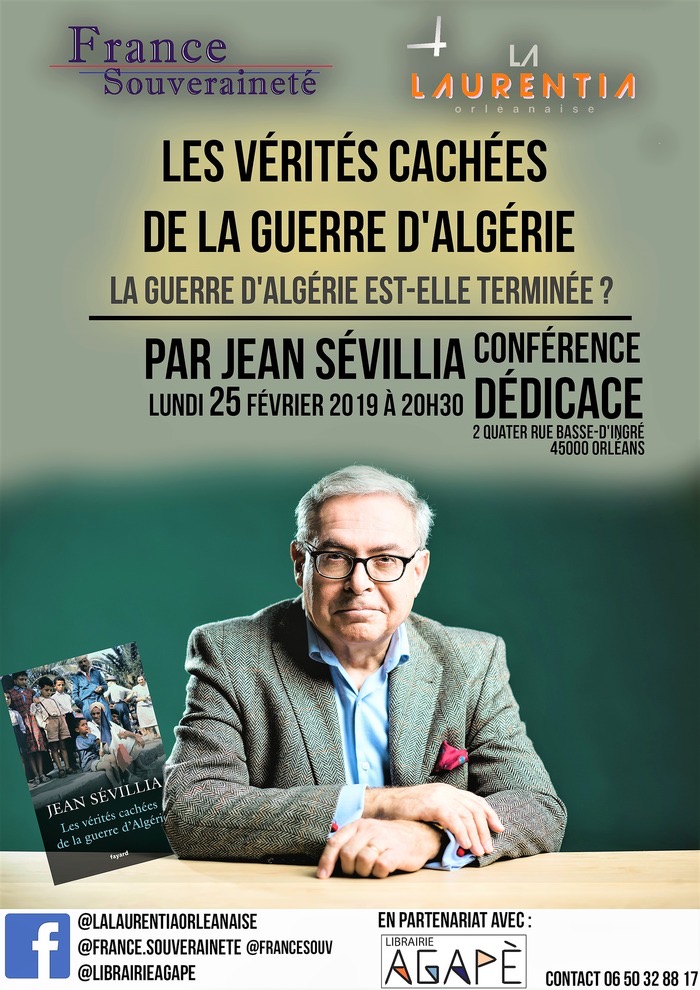
Faut-il donc enfoncer une porte béante pour dire que la colonisation française, différenciée selon les pays dominés, n’a pas été forcément une entreprise génocidaire systématique. Ce fut plutôt des crimes de masse ponctuels mais intolérables. La différenciation, le nuancement et la relativisation ainsi faits, il y a lieu de se pencher sur la façon dont certains cercles appréhendent en France l’idée même du fait colonial et des questions pendantes de devoir de mémoire, de reconnaissance et d’excuses. La France, à ce propos, a effectué des pas progressifs, significatifs certes, mais insuffisants. Le premier geste a été celui du président Jacques Chirac qui, en juillet 2005, à Madagascar, a reconnu «le caractère inacceptable des répressions engendrées par les dérives du système colonial». Le dernier en date est celui du président Emanuel Macron qui a reconnu à Alger même que la colonisation, par certains aspects, a été un crime contre l’Humanité.
En fait, ce qui est attendu de la France, ce n’est pas tant l’affirmation d’une injustice et des dérives continuelles et inacceptables du système colonial, que la reconnaissance des tragédies qu’elle a engendrées. Finalement, ce qui lui est demandé, ce n’est pas tant une repentance individuelle, qui serait cantonnée au domaine franco-algérien. C’est un devoir de vérité et de reconnaissance pour toutes les victimes de la colonisation française, quelles que soient leurs origines. En fin de compte, ce n’est pas verser dans le délire mémoriel, encore moins attiser la concurrence et la guerre des mémoires que d’accepter que les anciens peuples colonisés reçoivent comme juste réparation une reconnaissance expiatoire qui dénonce le fait colonial. Ce n’est pas la mémoire assumée, c’est évident, qui dresse les murs et nourrit la haine de l’Autre. C’est l’anti-repentance, entreprise d’auto-exonération qui renforce la concurrence conflictuelle des mémoires. Ne jamais l’oublier, le devoir de mémoire est un devoir de vérité, de reconnaissance. C’est même un impératif envers les vivants qui portent le poids d’un passé encore fortement présent, de part et d’autre.

N.K.